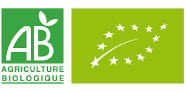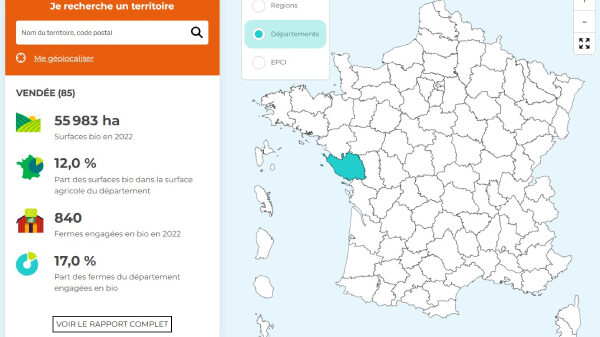Groupement des
agriculteurs et agricultrices biologiques
de Vendée
En un clic
Les chiffres clés
840
Fermes Bio
en Vendée
soit 17%
55 983
hectares Bio
en Vendée
soit 12%
120
interventions
dans les collectivités
120
formations
proposées par
le GAB en 2022
ACTUALITÉS
les événements à venir ...
A lire aussi
Ils nous font confiance
nos sponsors et financeurs