Découvrir la BIO
Accès rapides
La Bio, qu'est ce que c'est ?
L’agriculture biologique est née en Europe au début du siècle dernier sous l’influence de divers courants philosophiques et agronomiques qui avaient pour but de :
- permettre aux sols de conserver leur fertilité naturelle
- privilégier l’autonomie des exploitations agricoles
- établir des relations directes avec les consommateurs
- fournir des produits de qualité
- respecter l’environnement
L’agriculture biologique s’est développée en France à partir des années cinquante sous l’impulsion de producteurs qui se sont organisés afin de promouvoir un mode alternatif de production agricole qui repose sur des principes éthiques : écologiques, sociaux et économiques.

Les engagements de l'Agriculture biologique
Un Cadre réglementaire fort
Un cadre réglementaire fort
Une alimentation saine
Une alimentation saine
Garantie sans OGM
Garantie sans OGM
Des pratiques innovantes
Des pratiques innovantes
Reconnaître un Produit Bio

- Le LOGO AB ou le logo Européen permettent un repérage plus facile
- La référence à un organisme de contrôle est une réelle garantie
- La mention de l’origine des ingrédients agricoles est obligatoire
- Le pourcentage de matières agricoles biologique
- supérieur à 95% : les produits transformés ou bruts peuvent porter la marque AB
- inférieur à 95% : les ingrédients concernés portent la mention agriculture biologique mais pas le logo
- Sur les marchés les producteurs doivent être en mesure de présenter leur licence et leur certificat délivrés par un organisme certificateur après un contrôle
Logos

Les produits issus de l’agriculture biologique sont composés de plus de 95% d’ingrédients biologiques. Le logo européen apposé sur le produit permet au consommateur d’identifier immédiatement et sans aucune ambiguïté les productions biologiques, garantissant ainsi le strict respect des cahiers des charges. Sous ce logo, une mention » Agriculture UE » ou « agriculture France » permet d’identifier l’origine des matières premières agricoles (et non le lieu de transformation!) ce qui permet d’identifier si plus de 98% de ces matières premières agricoles sont d’origine française, ou européenne, ou « Non UE », voir dans un cas de mélange « UE/non UE ». Un repère important!
Le logo AB, propriété de l’état français, est désormais facultatif, mais encore très utilisé car connu des consommateurs.
Où Trouver des bons produits bio en vendée
Le GAB 85 s’associe au GAB 44 et au GABBANJOU pour vous proposer le site Bon Plan Bio.
Ce site vous permet, en quelques clics, de retrouver les produits bio proposés par les agriculteurs vendéens.
Rendez-vous sur leur ferme, dans des magasins de producteurs, des magasins bio, des AMAPs, des restaurants, sur des marchés…

La BIO EN VENdée
886
Fermes Bio
en Vendée
soit 18,1%
53 760
hectares Bio
en Vendée
soit 12%
18,1%
part des fermes du département en bio
11,6%
part des surfaces bio
dans la surface agricole
396
entreprises de l'aval
certifiées bio
*Chiffres de l’Agence Bio 2024
Des évènements pour découvrir l'Agriculture Biologique
Tout au long de l’année, de nombreux évènements ont lieu en Vendée afin de (re)découvrir la bio.
Vous pourrez retrouver :
- Le Printemps Bio, une campagne nationale offrant de nombreux rendez-vous de mi mai à mi juin chaque année.
- « Bio et local c’est l’idéal » cette campagne à lieu à partir du début de l’automne. Coordonnée par la FNAB, cette campagne de communication permet aux consommateurs de découvrir les circuits courts dans leur département.
- La Route de la BIO, jusqu’au 30 avril 2024 pour sa première édition, propose des itinéraires autour de la bio.

les événements à venir ...
Le Guide Biosceptique
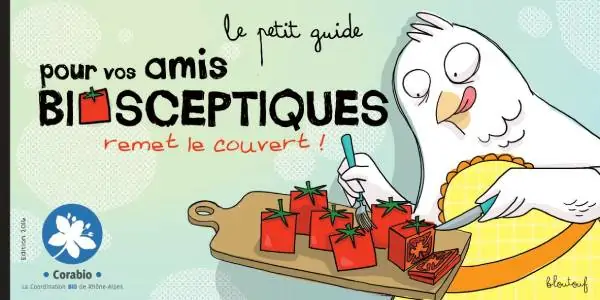
Corabio édite un petit livret argumentaire afin de répondre aux idées reçues sur la bio. 9 thèmes illustrés par une petite bande-dessinée, qui vous permettra de répondre du tac au tac aux remarques des sceptiques vis-à-vis de la bio. Bien référencé et illustré avec humour. A distribuer sans modération à vos amis les plus « biosceptiques » !
Manger bio, est ce vraiment plus cher ?
Des produits plus coûteux qu’il n’y parait
Le prix de nos aliments n’intègre pas :
- Les coûts de traitement de l’eau potable, très élevés en raison des pollutions diffuses liées aux engrais et aux pesticides chimiques de synthèse utilisés en agriculture
- Les subventions massives qui sont versées, au travers de la politique agricole commune (PAC), aux exploitations agricoles pour garantir leur compétitivité sur le marché
- Les dépenses de santé qui ne cessent de croître en raison du développement de certaines pathologies comme le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et certains cancers, en partie liées à notre alimentation industrielle et déséquilibrée.
Les prix pas toujours équitables pour les producteurs
Les prix ne reflètent pas toujours la réalité économique des exploitations agricoles. Pour rester compétitifs sur les marchés, les agriculteurs sont souvent contraints de vendre leurs productions à des prix inférieurs à leur coût de revient. Ils sont aujourd’hui dépendants des aides publiques pour assurer la survie de leur exploitation. Par ailleurs, une politique de bas prix incite les producteurs à renforcer la productivité de leur exploitation, souvent au détriment de la qualité des produits.
Produire en bio, ça coûte plus cher…
Les exigences particulières du cahier des charges de l’agriculture biologique engendrent des coûts de production supérieurs dans les fermes :
- L’alimentation des animaux, les produits naturels de lutte contre les maladies des plantes ou encore les semences sont plus chers en bio ;
- Les frais de main d’oeuvre sont plus élevés : à surface égale, une ferme bio nécessite davantage de main d’oeuvre qu’une ferme conventionnelle (surveillance accrue des troupeaux et des cultures, désherbage mécanique…) ;
- La certification et les contrôles, obligatoires pour pouvoir commercialiser les produits dans le circuit bio, sont payants ;
- Les densités d’élevage et les rendements sont plus faibles en bio et limitent le chiffre d’affaires ;
- Les coûts logistiques pour la collecte, la fabrication ou la distribution des produits bio, sont plus élevés. L’agriculture biologique étant insuffisamment développée en France (4 % des exploitations agricoles), les producteurs sont éparpillés
sur le territoire et les volumes en jeu sont limités, ce qui ne permet pas aux entreprises de réaliser des économies d’échelle.
En revanche, les fermes en AB tendent vers une autonomie importante (par exemple pour l’alimentation des troupeaux), elles sont donc un peu moins soumises aux évolutions des cours mondiaux de certaines ressources, ce qui peut permettre un impact plus limité sur le prix au consommateur »
Les bons réflexes pour manger bio sans se ruiner
- Acheter des produits locaux bio, de saison et en circuits courts : AMAP, Marchés de producteurs, vente directe à la ferme,…
- Privilégier l’achat en vrac, et sans suremballage.
- Consommer des produits le moins transformés ou peu transformés :
- Produits non raffinés : céréales complètes ou semi complètes
- Légumes et fruits bruts
- Eviter les plats préparés
- Eviter le gaspillage alimentaire en cuisinant les épluchures, fanes, congelé les surplus, faire des conserves lorsque c’est possible
- Varier les sources de protéines : Diminuer sa consommation de viande hébdomadaire et augmenter la consommation de légumineuses, céréales, oeufs ou poisson en conserves
- Connaître ses besoins et adapter sa consommation en conséquence
- Optimiser les DLC (Date limite de consommation) et DLUO (Date limite d’utilisation optimale)
Infos Enseignants
etablissement scolaires généralistes
Le GAB 85 met en place des projets pédagogiques qui font le lien entre Alimentation, Agriculture bio et Environnement dans l’objectif d’accroitre la part de bio local dans nos assiettes.
Vous êtes enseignant, Infirmier scolaire, assistant d’éducation, ou tout autre personne qui gravite autour d’un groupe d’élèves et vous souhaitez mettre en place un projet autour de l’alimentation responsable et durable, nous pouvons vous accompagner.
Dans un cadre bienveillant et respectueux de chacun, nous serons à l’écoute de vos envies et de vos besoins pour construire ensemble un projet qui vous correspond. Nous vous proposerons des outils pédagogiques variés, ludiques et sensoriels pour donner le plus de sens possible à votre projet.
- En savoir plus sur nos formations
Nino SIMON
Formulaire de contact ou 06 38 91 54 30

Intervention établissements agricoles
- Pour plus d’informations sur ce dispositif et nos interventions :
Guillaume BOUAS
Formulaire de contact ou 07 82 89 23 60
Pour en savoir plus
 Agence bio - découvrir la bio
Agence bio - découvrir la bioLe site de l'Agence Bio vous donne toutes les clés pour comprendre la bio
 Agence bio - Règlementation
Agence bio - RèglementationLe site de l'Agence Bio possède une page dédiée à la Règlementation Européenne de l'Agriculture Biologique
 Les fiches règlementaires FNAB
Les fiches règlementaires FNABPour faciliter la lecture la FNAB propose des fiches règlementaire synthétisant la la règlementation bio afin de la rendre accessible à tous et toutes.
Sites de référence
 Agence Bio
Agence BioL'Agence Bio est un groupement d’intérêt public en charge du développement, de la promotion et de la structuration de l’agriculture biologique française. Elle rassemble, au sein de son conseil d’administration, des représentants des Pouvoirs publics – le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Ministère de la Transition écologique et solidaire – et des professionnels (FNAB, APCA, Synabio et Coop de France).
 Interbio
InterbioINTER BIO des Pays de la Loire est l’interprofession régionale de la bio.
 fnab.org
fnab.orgLa FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France) réuni les producteurs biologiques au travers des GAB et GRAB.
 La cab
La cabLa coordination des Agriculteurs Bio en Pays de la Loire


